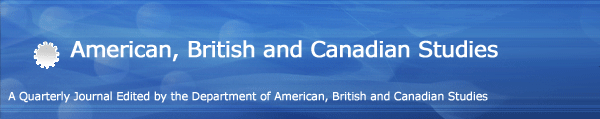| Espèces
de la langue parlée, les proverbes et les dictons appartiennent
à un code particulier déterminé par les limites
d'une langue et d'une certaine période historique. Conformément
à la thèse fondamentale de la linguistique, les signes
sont choisis en fonction d'un contenu de pensée, qui a imposé
leur utilisation. On met l'accent sur les éléments
produits par l'état affectif et la fantaisie du sujet parlant,
due à une réalité extralinguistique.
Si les proverbes sont des éléments connotés
(le signifié est transféré d’une sphère
sémantique à une autre), les dictons sont, tout au
contraire, des éléments non conditionnés.
Comme les proverbes et les dictons sont doués d'une grande
dose d'expressivité appartenant au peuple entier, notre communication
se propose de relever, grâce à la répétition,
certaines valeurs expressives de ces faits de langue.
La répétition est définie en général
comme un procédé stylistique qui consiste dans la
reprise d'un mot ou d'un groupe de mots pour exprimer l'intensité
d'une action ou d'une qualité et certaines situations circonstancielles
(la distribution, la progression, la durée etc.).
Le pouvoir expressif de la répétition est lié
à la nature linguistique du procédé. On ne
peut pas tracer une frontière nette entre la structure linguistique
et celle stylistique. La structure linguistique d'un énoncé
peut devenir structure artistique si les dénotations sont
remplacées par connotations provenant de l'actualisation
de l'expressivité.
La répétition illustre ce passage de la grammaire
logique au domaine de la stylistique, car elle est comme un supplément
à ce qui existe déjà et ne satisfait pas nos
nécessités affectives. Parfois, la reprise du mot
est accompagnée aussi par un changement de sens pour souligner
la nouvelle valeur.
Dans les proverbes, la répétition, comme procédé
stylistique, est utilisée pour nuancer l'émotion.
1. Conformément à certains buts artistiques,
qu'on essaie de présenter dans ce qui suit, la répétition
immédiate est une modalité de présentation
concrète par l'insistance sur l'un des termes de l'énoncé.
La formulation insistante vise à donner à l'idée
un surcroît d’authenticité :
Autant de pays, autant de guises.
Autant de têtes, autant d'avis.
Chose promise, chose due.
Tel travail, tel salaire.
Grand parleur, grand menteur.
Hors de vue, hors de souvenir.
Loin des yeux, loin du coeur.
À grande montée, grande descente.
Place libre, place prise.
Premier levé, premier chaussé.
Celui qui ne sait pas quand il fait garder le silence, ne sait pas
non plus quand il faut parler.
Comme tu auras semé, tu moissonneras.
Dur contre dur ne font pas bon mur.
Goutte à goutte, l'eau creuse la pierre.
Morte la bête, mort le venin.
Qui fait bien trouve bien.
Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son.
Qui peut le plus peut le moins.
Qui veut la fin veut les moyens.
Rira bien qui rira le dernier.
On n'a rien sans rien.
2.
Morphologiquement les termes qui se répètent, le plus
souvent, sont des adverbes et des verbes. Parfois, le verbe qui
se répète apparaît, à la forme négative
ou dans une structure négative, dans la seconde partie du
proverbe, créant ainsi l'antonymie parémiologique.
Il arrive en une heure ce qui n'arrive pas en cent.
On voit une paille dans l'oeil de son prochain et on ne voit pas
une poutre dans le sien.
Le chat aime le poisson, mais il n'aime
pas à se souiller les pattes
Qui demande à crédit ne demande pas au poids.
Mal sait parler qui se taire ne sait.
Qui est propre à tout n’est propre à rien.
Qui trop veut prouver ne prouve rien.
Dans la répétition double (même triple), les
deux (ou trois) termes compris sont repris soit dans la deuxième
partie, soit dans le cadre de la même partie du proverbe:
Oeil pour oeil, dent pour dent
Pas de fumée sans feu, ni de feu sans fumée.
Le mot répété confère du relief au contexte.
La reprise peut mettre en évidence une antithèse,
des correspondances ou des corrélations.
La répétition est parfois riche et couvre tout le
proverbe ce qui fait apparaître une symétrie parfaite.
La combinaison de l’antithèse avec l’inversion
crée une opposition sur le plan des idées.
Les fous sont plus utiles aux sages que les sages aux fous.
Manger pour vivre, et non vivre pour manger.
Qui médie des autres devant toi, médira de toi devant
les autres
Qui n’aime son métier, son métier ne l’aime.
Bouche en coeur au sage, coeur en bouche au fou.
Dans
ces proverbes, la reprise contraint le lecteur à la réflexion
nuancée. On reprend les mêmes mots pour mettre l’accent
sur ceux qui sont différents, la répétition
contribuant ainsi à la résonance du sens.
3.
Ce qui intensifie aussi la valeur expressive du proverbe est la
répétition de structure.
3.1. On reprend les mêmes termes
ayant des fonctions syntaxiques différentes :
sujet – complément Argent appelle argent
Abîme attire un autre abîme.
Complément – sujet Ce qui vient de pille, pille s’en
va de tire.
Complément – complément Du diable vient, au
diable retournera.
On ne donne rien pour rien.
Qui sert à l’autel, doit vivre de l’autel.
Sujet – attribut Les affaires sont des affaires.
Le loup est toujours loup et mourra dans sa peau.
Attribut – complément Tout est bien qui finit bien.
3.2.
Apparenté à ce type de répétition est
celui où l’on reprend des termes à base lexicale
commune :
À force de forger on devient forgeron.
Chat et chaton chassent le raton.
Dépends le pendard, il te pendra.
Qui ne veut point danser ne doit se mettre en danse.
Qui premier arrive au moulin, premier doit moudre.
Le bossu ne voit pas sa bosse, mais il voit celle de son compagnon.
À l’oeuvre on connaît l’ouvrier.
Qui vole une fois est appelé voleur.
Ce que pense l’âne, ne pense l’ânier.
Il viendra moudre à mon moulin.
3.3.
Le changement du verbe, de la voix active à celle pronominale,
d’un mode verbal à l’autre (indicatif –
subjonctif; infinitif – indicatif; indicatif – infinitif;
infinitif – gérondif; impératif – indicatif)
et d’un temps à l’autre (présent –
futur) dans le cadre du même mode, rend le contexte expressif
:
Qui garde bouche, se garde son âme.
Dieu me garde de mes amis ! Je me garderai de mes ennemis.
Qui n’a argent en bourse ait miel en bouche.
Pense deux fois avant de parler,
Tu en parleras deux fois mieux.
Mieux vaut pauvre et homme de bien que riche et ne valoir rien.
On ne peut faire qu’en faisant.
Aide-toi, le ciel t’aidera.
Qui a bu boira.
Qui frappe veut être frappé.
Qui trompe aux épingles, trompera aux écus.
Qui vole aujourd’hui un oeuf, demain volera un boeuf.
Tel est pris, qui croyait prendre.
À ne rien faire, on fait des dettes.
Faute de se fâcher une bonne fois, on se fâche tous
les jours.
Gardez votre maison, elle vous gardera.
4.
Caractérisés par symétrie et concision les
proverbes et les dictons peuvent, également, capter l’attention
de l’interlocuteur, en l’impressionnant, par la répétition
de formes :
- l’épiphore : Ce que femme veut
Dieu le veut
Pas de nouvelles
Bonnes nouvelles.
Mieux vaut avoir
Qu’espoir d’avoir
-la
paronomase : Raison fait maison.
Vouloir c’est pouvoir.
Qui s’excuse s’accuse.
Qui refuse muse.
Du savoir vient avoir.
Bonté passe beauté.
Beaucoup de bruit, peu de fruit.
Argent changé, argent mangé.
Conclusions
:
Les remarques présentées n’ont pas la prétention
d’épuiser le registre des fonctions stylistiques de
la répétition. Mais, nous pouvons, pourtant, formuler
quelques observations sur les effets expressifs de ce procédé
:
- la répétition du même lexème dans les
deux parties du proverbe ou du dicton (Autant de têtes, autant
d’avis) permet l’apparition des corrélations
entre les deux séquences. Les couples oppositionnels soulignent
les relations de détermination, de causalité et participent
à l’ordre moral du monde qui gouverne une société.
Greimas (Despre sens, 324) considère que l’étude
des nouveaux couples oppositionnels pourrait permettre d’établir
les thèmes et la structure du système de significations
constituées par les proverbes et les dictons d’une
communauté linguistique à une certaine époque.
- l’emploi fréquent du temps présent et des
modes verbaux indicatif et impératif met mieux en évidence
la place importante que le proverbe et le dicton occupent dans le
discours. Le temps présent, utilisé dans de simples
constatations, sert à énoncer des vérités
éternelles.
- la répétition des mots en rime favorise une compréhension
affective et le message s’imprègne mieux.
Arrivés
à ce point du travail nous considérons que, dans la
parémiologie, les rôles stylistiques de la répétition
ne diffèrent pas fondamentalement de ceux de la langue littéraire
écrite.
BIBLIOGRAPHIE
Dictionnaire
de la langue française – Lexis, Larousse, Paris, 1994.
Fontanier, P., Les figures du discours, Flammarion, Paris, 1977.
Gorunescu, E., Dictionar de proverbe român-francez, Editura
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1978.
Greimas A. J., Despre sens, Editura Universitatii, Bucuresti, 1975.
Maloux, M., Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, Paris,
1961.
Pineaux, J., Proverbes et dictons français, Presses Universitaires
de France, Paris, 1967.
Reboul, O., La rhétorique, Presses Universitaires de France,
Paris, 1990.
|